Dežurni telefon: +381 61 63 84 071
Femmes réfugiées : perspective de la Serbie

Marijana Savić, directrice de l’ONG Atina, offre un aperçu approfondi des efforts d’Atina pour répondre aux besoins des femmes réfugiées. La perspective de genre est souvent négligée lorsqu’il s’agit de discuter de la crise actuelle ; c’est pourquoi les activités et la vision d’Atina sont particulièrement importantes et nécessaires, tant sur le terrain que dans les processus de prise de décision.
Quelles sont les principales activités d’Atina en lien avec la réponse d’urgence à la crise des réfugiés ?
Étant donné que nous sommes une organisation de femmes et féministe, nous avons observé les femmes qui se trouvent sur ce parcours, et nous avons constaté que personne ne leur prêtait attention. En raison de leur vie dans des sociétés patriarcales et du fait que de nombreuses choses ne leur sont pas accessibles, elles se cachent encore davantage et se réfugient derrière certaines personnes — parfois des membres de la famille bien intentionnés, parfois non — mais le plus souvent derrière des hommes qui, sur cette route, endossent le rôle du système patriarcal : ils dirigent et prennent les décisions.
Nous avons également remarqué qu’il n’existait absolument aucun mécanisme permettant d’atteindre ces femmes et de répondre à leurs besoins. Nous avons donc décidé qu’Atina consacrerait une partie de ses ressources à développer ses capacités dans ce domaine, car nous n’étions pas prêtes non plus au départ. C’est pourquoi nous sommes désormais présentes partout où se trouvent des femmes et des filles réfugiées.
La raison pour laquelle nous sommes désormais impliquées dans la réponse à la crise des réfugiés, et particulièrement dans la réponse aux besoins des femmes et des filles en déplacement, est principalement le fait que des femmes et des enfants ayant subi une forme de violence étaient orientés vers nos programmes. Ce qui nous a poussées à réorienter nos ressources, nos connaissances et nos compétences acquises au cours des 13 dernières années, consacrées à la protection des victimes de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, c’est le fait que ce sont généralement les filles qui sont nos bénéficiaires ; nous connaissons la cause principale de leur vulnérabilité, notamment à la violence sexuelle, ainsi qu’à d’autres types de violence. Nous nous sommes rendues dans les zones où se concentraient les réfugiés venus de différents pays, et où ils se rassemblaient, et à ce moment-là, nous avons constaté leur impuissance, mais aussi leur détermination à trouver une vie, qu’ils n’avaient pas véritablement, et je peux affirmer que pour beaucoup d’entre elles, cette situation a duré plusieurs années.
Qu’est-ce qu’Atina considère comme prioritaire dans son travail de soutien aux personnes ayant subi une violence basée sur le genre ?
D’une part, notre objectif est d’aider d’autres organisations à inclure ce prisme et cette perspective dans leur soutien aux réfugiés, et à être capables de reconnaître certains signaux précoces indiquant qu’une personne est en difficulté, de reconnaître les besoins des femmes, de comprendre qu’elles ont des besoins différents, ou similaires mais exprimés différemment, d’être sensibilisées à toutes les horreurs qui peuvent survenir en chemin, et pas seulement de rechercher les cas de violences basées sur le genre ou de traite des êtres humains, car il est difficile de les détecter sans mécanisme préétabli et sensibilisé qui permette aux femmes de s’approcher et de partager leur expérience sans crainte.
D’autre part, personne ne dira spontanément : « Oui, je suis une victime, j’ai subi telle ou telle violence, j’ai été violée ici et maintenant je viens vous le dire » ; un climat de soutien doit exister pour que quelqu’un puisse le faire. Ce climat ne doit pas être menaçant, et dans la réponse actuelle tout est non-soutenant et menaçant, à commencer par la manière dont les critères déterminent qui est réfugié et qui ne l’est pas, et qui change d’heure en heure. Cela s’applique à l’ensemble de la population en déplacement actuellement, hommes et femmes, mais il existe une différence dans la façon dont ces informations parviennent aux femmes et aux hommes. La plupart du temps, ce sont les hommes qui ont ces informations, et la question est de savoir s’ils veulent les partager ou non. Les femmes qui arrivent sont moins éduquées, n’ont pas eu la possibilité d’aller à l’école, ont vécu dans un environnement traditionnel où elles ne peuvent pas communiquer avec les autres, surtout s’il s’agit d’hommes, ne connaissent pas de langue étrangère et doivent simplement se fier à celui qui mène le chemin – qui peut être un passeur, une personne bien intentionnée, ou quelqu’un qui les abuse durant ce voyage.
Nous rencontrons souvent des filles mineures dont l’âge est difficile à estimer – elles semblent avoir 14, 15 ou 16 ans, peut-être moins, peut-être plus, déjà mariées et enceintes lors de ce voyage. Nous n’avons pas de réponse adaptée à cela. Notre système ne dispose pas de mécanismes pour les mariages d’enfants, même dans notre société.
Y a-t-il quelque chose qui peut vraiment les aider ?
En écoutant ces femmes et en discutant avec elles, on se rend compte que certaines choses simples pourraient résoudre certains problèmes, mais elles ont peur, elles craignent pour elles-mêmes, pour leur fille, elles craignent d’être agressées sexuellement ou exploitées, et nous les plaçons avec des hommes, dans les mêmes locaux, pour passer les nuits et les journées, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à un niveau politique élevé, sans se soucier de ce qu’elles ressentent. Les femmes ont faim d’informations, des informations les plus basiques – où elles se trouvent, quels services sont disponibles pour elles à cet endroit, où elles se dirigent et ce qui les attend là-bas, quels sont leurs droits, combien quelque chose leur coûtera – ces informations ne leur parviennent pas, car elles sont partagées avec un homme qui parle la langue. Personne ne leur demande comment elles se sentent.
Nous rencontrons souvent des personnes sur le terrain qui témoignent de violences domestiques, des violences agressives et transparentes. J’ai spécifiquement demandé à certains policiers s’ils y étaient confrontés ; ils disent que oui. Que font-ils ? Ils disent qu’ils détournent le regard, qu’ils ne réagissent pas pour diverses raisons : ils ne veulent pas heurter la fierté de ces femmes, car elles ont survécu à beaucoup de choses, ce sont des femmes fortes – qu’est-ce qu’un simple cas de violence domestique lorsque ces femmes s’occupent de neuf enfants et passent des mois sur la route, à travers collines et montagnes avec leur famille, elles s’occupent de la famille, donc les policiers ne veulent pas les embarrasser ; ou bien elles sont impuissantes et les policiers ne veulent pas les interrompre dans ce voyage, car elles sont en transit, elles entrent au sud, se dirigent vers le nord et répètent : « Croatie, Croatie ! » ; ou encore parce qu’elles ont honte, sont embarrassées d’en parler, et trouvent plus facile de détourner le regard. Ce sont ces trois raisons.
Comment est-il possible de soutenir les femmes réfugiées ?
Dans notre mécanisme de protection, les femmes réfugiées sont vues uniquement comme des mères. Leurs besoins sont considérés uniquement comme maternels, donc des espaces adaptés aux enfants sont créés pour prendre soin des enfants. Les enfants concernés sont jusqu’à 5 ans, et personne ne s’occupe des adolescents ou de ceux de plus de 9 ans. Les femmes sont vues comme des mères et futures mères – des examens gynécologiques sont réalisés, les grossesses sont suivies, etc. Les besoins des femmes dans le système sont toujours examinés à travers ce prisme, qui est également un cadre patriarcal, et les femmes sont également perçues de cette façon dans notre société. Ici, on entend toujours – où sont nos jardins d’enfants, où sont nos cliniques gynécologiques, la santé reproductive des femmes est une préoccupation – ce qui est très important, mais ni la santé mentale ni la santé physique des femmes n’est prise en considération, il n’y a aucun soutien général pour une femme.
Et même lorsque nous parlons de la garde des enfants, sous l’hypothèse qu’une femme vient d’une société traditionnelle où s’occuper des enfants est sa responsabilité, une femme voyageant avec un fils de 16 ans et de jeunes enfants de 5 ou 7 ans ne pourra pas les laisser dans un espace adapté aux enfants parce que cet enfant de 16 ans n’est pas considéré comme un enfant, et peut-être qu’il n’existe même pas un tel espace, et elle doit aller aux toilettes. Où laissera-t-elle les enfants quand elle ne peut pas entrer aux toilettes avec eux ? Elle n’a pas de temps pour elle-même durant ce voyage. Où ces femmes se lavent-elles ? Existe-t-il des endroits sûrs pour qu’elles partagent leurs expériences, se détendent et sortent simplement du rôle de mère, pour que quelqu’un puisse les approcher en tant que femmes, et non en tant que mères ?
En ce qui concerne l’évolution de la situation liée à la crise des réfugiés, une partie des ressources devra probablement être consacrée à l’intégration. Quels sont les défis qui nous y attendent ?
Ces défis sont énormes, car personne ne s’en est occupé, et tout le monde ferme les yeux lorsqu’on en parle, car l’intégration coûte cher. L’intégration et la protection des personnes qui restent ici nécessiteraient la construction d’un système sérieux et couvriraient une variété de domaines qui doivent être planifiés : l’éducation, la santé, les procédures administratives, la protection sociale et le travail. Au moins cinq des systèmes mentionnés devraient apporter des modifications pour aligner leurs règles sur les besoins d’intégration de ces personnes qui souhaitent rester ici. Cela se produira certainement à l’avenir, et nous sommes déjà en retard dans la planification de ce processus, surtout dans le sens où, en tant que société, nous bénéficions de ces personnes : elles ne sont pas les seules à bénéficier de la protection qu’elles recevraient ici. Nous voyons cela uniquement comme une conséquence, et en réalité, nous ne percevons pas l’opportunité offerte à ce pays, car des personnes merveilleuses, dotées de grandes compétences et d’une diversité qui ne peut que nous enrichir, arrivent ici.
Et lorsque tout cela sera planifié, non seulement dans notre société mais dans le monde entier, le système d’asile est conçu pour l’homme politiquement actif et persécuté dans un pays donné, et il y a une douzaine de telles personnes, et non en fonction de ce qui nous est réellement arrivé. Ce sont des persécutions et des guerres affectant de nombreuses personnes, femmes et hommes. Cette protection est une fois de plus mise en place de manière à ne pas prendre en compte la perspective de genre, ni les expériences des femmes, ni celles des hommes dans cette forme de persécution, cette forme de souffrance qu’ils vivent, ni leurs spécificités dans le contexte de la société dont ils sont issus. Les politiques changent quant à qui est réfugié et qui ne l’est pas ; l’autre jour, l’entrée des Afghans dans le pays a été interdite. Nous avons entendu le témoignage d’une femme afghane qui explique explicitement – depuis sa naissance, la guerre fait rage dans son pays, depuis 1978, lorsque la Russie a envahi l’Afghanistan. Elle et ses enfants ne peuvent pas aller à l’école, ne peuvent pas se déplacer librement dans les rues, non seulement à cause des bombes, mais aussi à cause d’une société qui réprime pratiquement toutes les femmes, qui ne leur permet pas d’aller à l’école, qui les menace de sanctions si elles se marient et ne respectent pas le mari, si elles veulent quitter une communauté violente, si elles défendent les droits humains, et tout le reste. Les femmes de cette communauté spécifique sont réfugiées selon tous les critères. Si elle dit qu’elle n’a pas pu inscrire sa fille de 16 ans à l’école, et si elle-même n’a pas pu aller à l’école, si les bombes tombent chaque jour même si le pays n’est pas officiellement en guerre, simplement parce qu’elle est une femme en Afghanistan qui veut réaliser quelque chose, elle devrait bénéficier ici d’une protection, selon tous les critères, car ses droits humains lui sont refusés.
Il est donc nécessaire de mettre en place tout un nouveau mécanisme pour que l’intégration ne soit pas vue comme un cours de langue donné par des bénévoles une heure par semaine, mais comme une solution où ce cours constitue la première étape vers l’entrée dans un système. Les enfants présents ici doivent être immédiatement inclus dans le système scolaire, et en ce qui concerne l’ordre social, nous devons parler du fait que les personnes qui cherchent protection doivent être informées de l’ordre social, juridique et politique local. D’une part, elles doivent en être informées, et d’autre part, il est nécessaire qu’elles assument ces obligations et agissent en conséquence, car nous devons être conscients que ces personnes viennent de régions et de pays où des filles dès 12 ans n’ont pas le droit de sortir seules en public sans être accompagnées d’un homme adulte. Il doit également y avoir un renforcement économique, un système de protection sociale doit être créé pour fournir un logement adéquat, mais aussi une évaluation sérieuse des besoins, compétences, ressources et capacités de ces personnes, afin qu’elles soient orientées vers des programmes leur donnant les compétences pour devenir compétitives et utiles à notre société, et pour qu’elles puissent s’engager sur le marché du travail. Cela vaut pour les hommes comme pour les femmes et doit être un principe directeur et un engagement. Atina, en tant qu’organisation, fait cela depuis des années avec ses bénéficiaires, mais ces activités concernent un nombre beaucoup plus restreint de personnes et nécessitent certaines adaptations, ainsi que l’effort de différents systèmes pour apporter des changements dans leurs mécanismes afin de pouvoir inclure ce nombre de personnes à l’avenir, car il faut cesser de penser que ces personnes ne sont que de passage.
Quels sont les plus grands défis pour vous tous qui travaillez actuellement à l’ONG Atina ?
Ce qui aiderait Atina serait la création d’un mécanisme incluant tous les acteurs capables d’adopter une perspective de genre dans la réponse apportée. Cela ne peut pas se limiter à une, deux ou trois organisations, car ce n’est pas une solution. Ce serait une aide réelle – Atina souhaiterait que des mécanismes soient mis en place afin que les besoins différents des différents groupes soient pris en compte de manières adaptées, et que les hommes et les femmes au sein de ces groupes soient pris en considération, en clarifiant que les enfants, garçons et filles, ont leurs propres besoins et que les activités doivent être organisées en conséquence.
Il est également important de réfléchir sérieusement à la création de programmes de soutien pour l’inclusion des personnes qui demandent protection ici et qui resteront ici, dès que possible – hier, avant-hier – et que ces programmes soient complets et dépassent le cadre d’un simple soutien technique, car il doit être clair que les personnes dans cette situation ont aussi besoin de motivation. C’est justement ce qui fait défaut actuellement.
Nous devons absolument construire des mécanismes permettant de disposer d’un espace de réflexion, ce que nous n’avons pas réussi à faire jusqu’à présent, afin de pouvoir faire une pause, de nous accorder un moment de répit et de fournir un regard objectif sur la situation, et pas seulement subjectif, car nous sommes profondément impliqués dans le sujet. Nous pensons constamment pouvoir en faire plus, mais la question est : pouvons-nous vraiment ?
Le plus grand défi pour Atina jusqu’à présent est que nous avons appris à travailler individuellement, en tête-à-tête – nous avons une femme survivante, avec elle nous établissons un plan, puis un suivi à long terme pour l’aider à le réaliser. Or ici, il s’agit d’une masse de personnes, et il faut être un soutien pour celles qui n’ont aucune idée de la situation, tout en étant sur le terrain pour aider directement ces personnes, détecter le besoin potentiel d’une personne sur la base de certains indicateurs, puis prendre en charge l’ensemble du suivi du cas, en travaillant individuellement, même si l’on ne sait pas ce qui va se passer avec cette personne, car tout ne dépend pas de nous.
Une politique différente est en place, où la situation dépend de l’appartenance de la personne à tel ou tel groupe ethnique, nationalité, si l’Autriche va fermer la frontière, si la Serbie va fermer la frontière, s’il y aura un changement de politique migratoire – tous ces facteurs représentent des défis, et c’est terriblement frustrant pour nous. Il est souvent problématique de se concentrer sur un seul cas – on se demande pourquoi seulement elle, alors qu’il y a des milliers de personnes dans la même situation – mais nous pouvons aider une ou deux femmes, ce qui engendre de la frustration et nécessite un soutien professionnel.
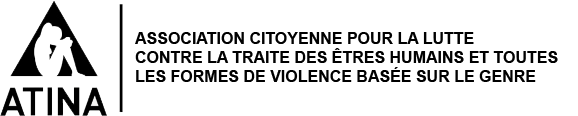

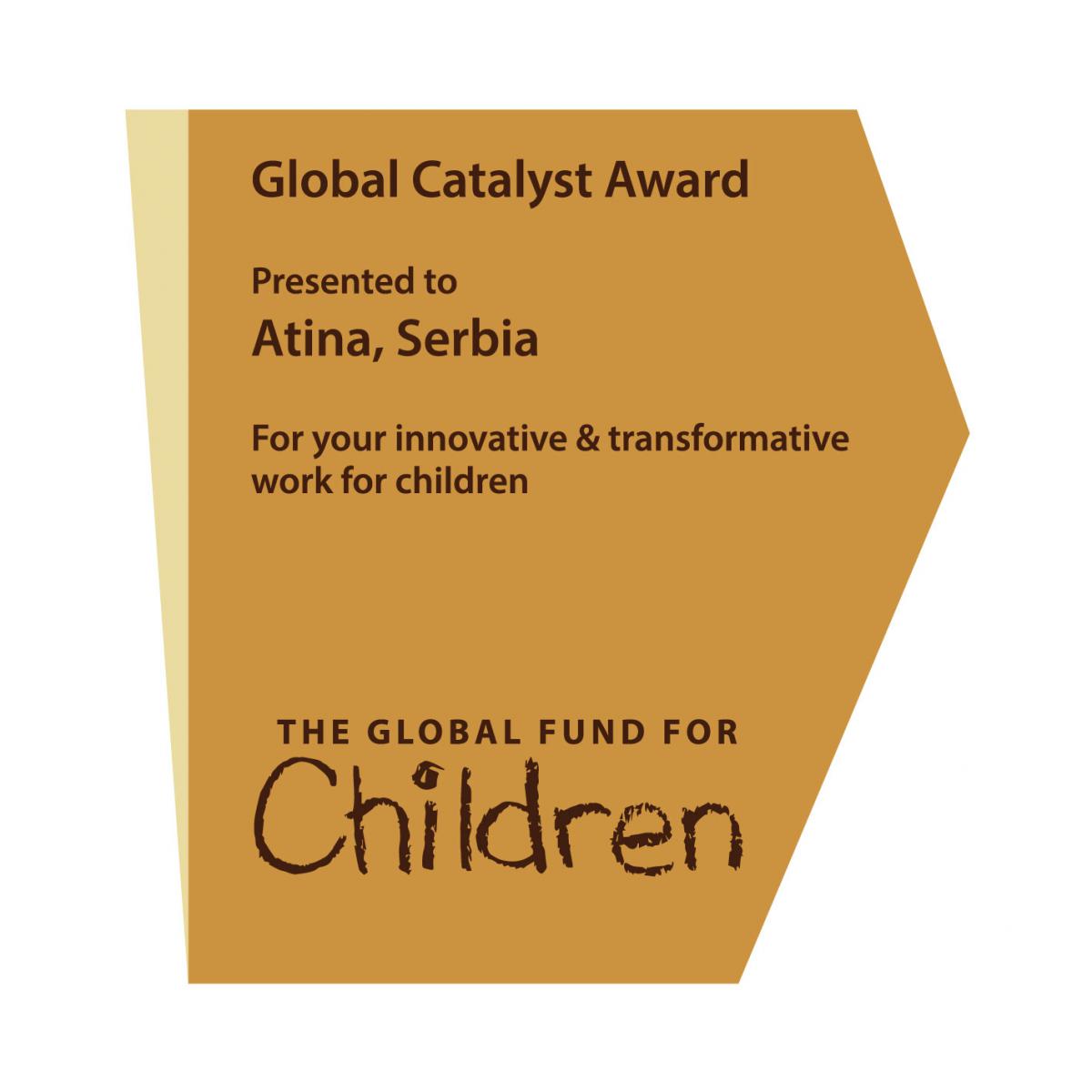







 FACEBOOK
FACEBOOK TWITTER
TWITTER YOUTUBE
YOUTUBE