Dežurni telefon: +381 61 63 84 071
Peu importe la difficulté, l’humanité et le bien en nous refont surface.

Dragana Cuk, psychologue à l’ONG ATINA, discute de l’état psychologique des réfugiés en route et des défis pour les activistes des équipes mobiles.
Il est très difficile pour les gens de comprendre la situation des personnes en voyage, qui ont dû fuir leur pays. La question est donc : quel est le point de départ et la vision des personnes qui représentent Atina sur le terrain ? Quelles informations de base possèdent-elles sur l’état des personnes fuyant la guerre ?
Tous les employés, ainsi que les collaborateurs d’Atina travaillant sur le terrain, ont suivi une formation avant de commencer leur travail, afin d’être préparés à faire face à ces circonstances. Il est très difficile d’être complètement prêt, surtout sur le plan psychologique ; malgré les compétences qu’ils possèdent, pour les conditions sur le terrain, ils peuvent dans une certaine mesure aider les autres et se protéger eux-mêmes. Les deux aspects sont importants.
Il est extrêmement important de comprendre les situations spécifiques dans lesquelles se trouvent ces personnes et le traumatisme qu’elles vivent. Parfois, j’entends que le stress est mentionné, ou que la situation est qualifiée de « stressante ». À mon avis, ce qu’elles vivent dépasse le stress : c’est un traumatisme lié à la guerre. Quand on pense à ces personnes, on pense à leur voyage depuis le moment où il a commencé et à tout ce qu’elles expérimentent en chemin. Il est très important de tenir compte de ce qu’elles ont vécu avant. Elles n’ont donc pas commencé leur voyage en tant que personnes heureuses, mentalement et physiquement saines, adultes, avec de l’argent, etc. Les personnes qui décident de commencer ce voyage ont déjà été exposées à un stress et à des traumatismes prolongés dans les lieux où elles vivaient. C’est l’état avant leur départ, en termes de ressources mentales. Commencer ce voyage est un acte de courage, sachant ce qui les attend, surtout pour les parents avec enfants.
Je parle ici des aspects psychologiques, dans le cadre du rôle à jouer : être celui ou celle qui est fort(e), qui porte tout, qui reste toujours calme, comme le demande chaque culture, et surtout celle dont elles viennent. Il n’est pas facile, dans ces circonstances stressantes et traumatisantes, de rester calme et de prendre les bonnes décisions, quelles qu’elles soient, d’être un soutien pour les autres, de ne pas montrer que cela est difficile pour soi et de gérer tout cela. Elles vivent donc elles aussi leur épreuve.
D’autre part, ce qui est spécifique à Atina, c’est l’attention portée aux femmes et aux enfants. Un fardeau supplémentaire, principalement émotionnel, que portent les femmes et les enfants – les femmes subissant différentes violences avant leur départ et, pendant le transit à travers différents pays, elles sont très vulnérables et exposées à la violence sexuelle, en particulier les jeunes femmes. Parfois, nous entendons de belles histoires humaines, où les personnes, en fonction de leur culture, créent des liens avec des étrangers complets, issus de la même région de leur pays. Dans ces situations, peu importe la difficulté, l’humanité et le bien en nous refont surface.
Les choses traumatisantes que les réfugiés portent avec eux au début du voyage incluent la peur pour leur vie et celle de leurs enfants, les difficultés physiques à se déplacer, car une grande partie du voyage se fait à pied, dans des conditions où les chaussures sont usées, et marcher n’est pas seulement physiquement épuisant mais aussi dangereux pour les pieds. De plus, il faut s’occuper des enfants qui doivent être portés quand ils ne peuvent plus marcher. Écouter leurs histoires et vivre avec la conscience que, si elles sont laissées derrière, les femmes et les enfants sont plus susceptibles d’être abandonnés, car le groupe essaie de survivre et de continuer le voyage sans attendre ceux qui restent en arrière. La peur liée à « comment vais-je survivre ? » se combine à des situations traumatisantes, comme les enfants qui se noient et les parents qui assistent à ces drames dans des bateaux inadaptés à la navigation.
Nous avons entendu différentes histoires traumatisantes et je pense que c’est, avant tout, la première chose à comprendre pour toute personne travaillant sur le terrain : comprendre les personnes dans le besoin, identifier le traumatisme et les modes d’expression qui peuvent défier nos préjugés. Il est conditionnellement plus facile de gérer les symptômes d’un traumatisme qui se relie clairement à la souffrance d’un autre être humain, car là, nous compatissons et il y a moins de risque de faire quelque chose qui pourrait victimiser davantage la personne.
Il est particulièrement important de souligner les comportements qui sont des manifestations de traumatisme et qui peuvent être stigmatisés. Par exemple, un symptôme de traumatisme dans le rôle parental est la surprotection de l’enfant, le fait de ne pas le laisser s’éloigner, ce qui peut être interprété selon divers préjugés, notamment culturels, surtout envers les personnes issues de cultures arabes, ouvrant ainsi un espace à une victimisation secondaire. De telles situations spécifiques sont très importantes. Les enfants qui pleurent, crient, ne se calment pas, n’écoutent pas ou ne respectent pas les consignes, sont souvent étiquetés comme « mal élevés » ou « gâtés », alors que cela peut être une manifestation du traumatisme. Le manque de confiance envers les autres est souvent un signe de traumatisme, surtout en raison des arnaques rencontrées en chemin par des passeurs ou de réponses négatives des professionnels.
Une partie très importante du travail sur le terrain est la question des préjugés, pour éveiller la conscience des préjugés propres et leur interprétation. Il serait idéaliste de s’attendre à éduquer quelqu’un sans préjugés, mais il est essentiel de savoir les reconnaître. Il est humain d’avoir des préjugés, mais si une personne les reconnaît, cesse ce comportement et n’agit pas sur la base de ces préjugés, cela ouvre un espace pour établir un bon contact.
Les spécificités culturelles sont très importantes. Une partie de la formation concerne les compétences de communication, qui sont culturellement sensibles, changeantes, et tiennent compte de la culture. Avec mes collègues venant de Syrie, Afghanistan et d’autres pays d’où viennent les réfugiés, nous avons vérifié surtout la communication non verbale : ce qui est permis ou non, en fonction du genre, de l’âge, etc.
Une autre compétence très importante est la manière de se protéger et de gérer le stress, car il provoque du stress chez les travailleurs humanitaires. Les personnes traumatisées peuvent présenter des symptômes de stress post-traumatique, et les aidants, exposés secondairement à des événements traumatisants, peuvent développer des symptômes similaires, affectant le sommeil et l’appétit. Il est donc crucial de savoir se protéger et de se soutenir mutuellement pour durer, être utile aux autres et être satisfait de soi-même.
Les femmes réfugiées font part d’une peur supplémentaire liée à leur genre, concernant leur sécurité et celle de leur famille, surtout si elles ont des filles. L’approche d’Atina consiste à reconnaître l’exploitation, prévenir le risque et intervenir lorsqu’il y a suspicion de violence continue. La coopération avec les Centres de Travail Social et les Services de Protection Sociale est essentielle, surtout pour les mineurs non accompagnés. Des indicateurs spécifiques ont été développés pour identifier les enfants ou jeunes à risque. Il est improbable qu’une victime ou une personne à risque s’exprime ouvertement par peur. Il est donc crucial de reconnaître les indicateurs et de créer un lien de confiance, sans obliger à parler, offrant un terrain sûr.
Lorsque les personnes arrivent à destination, l’intégration commence réellement. Atina travaille à familiariser les réfugiés avec l’environnement du pays d’accueil, à identifier les préjugés et les valeurs différentes nécessitant un certain ajustement. Dans les situations d’urgence sur le terrain, il y a moins de place pour la prévention, mais cela viendra progressivement.
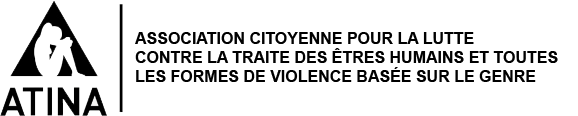

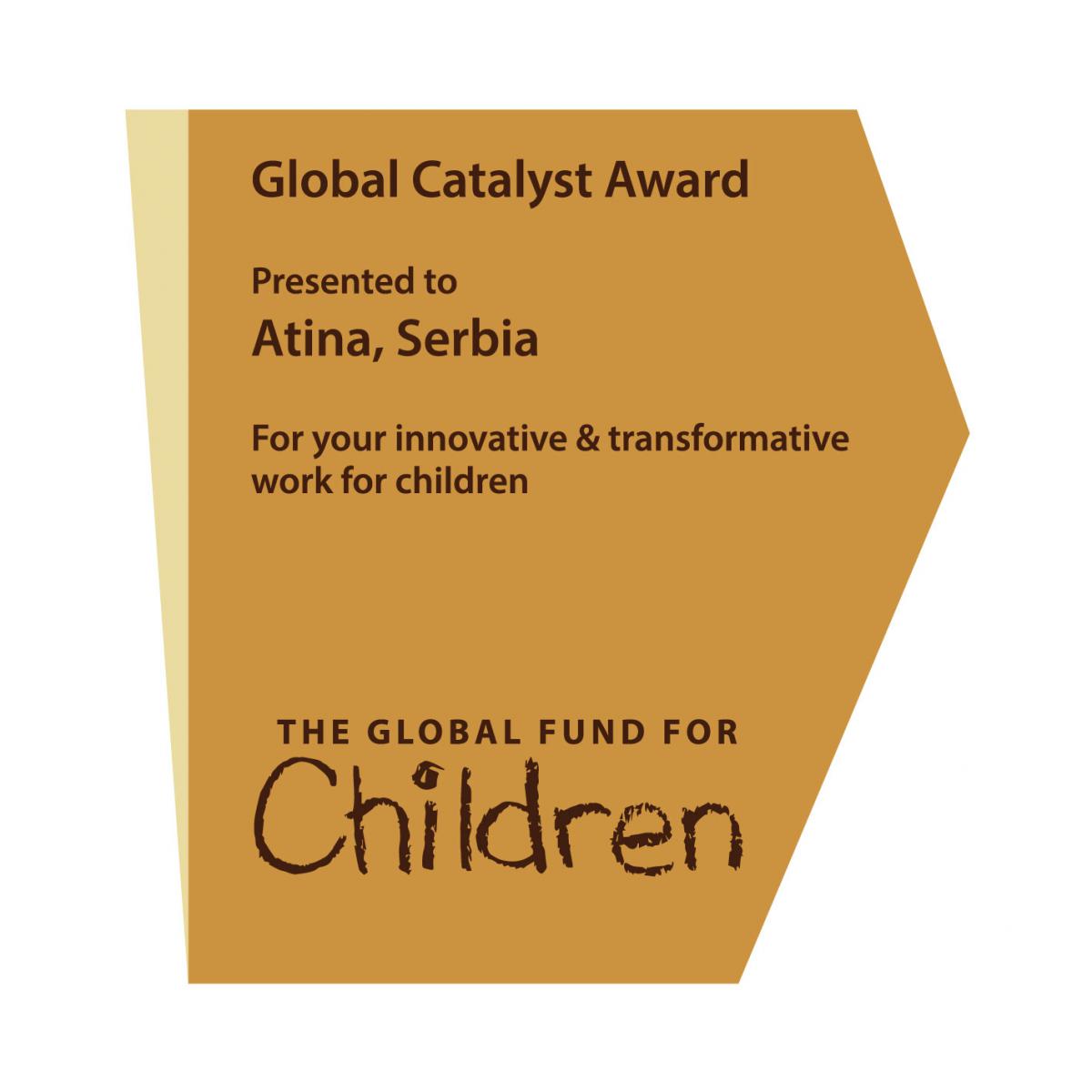







 FACEBOOK
FACEBOOK TWITTER
TWITTER YOUTUBE
YOUTUBE